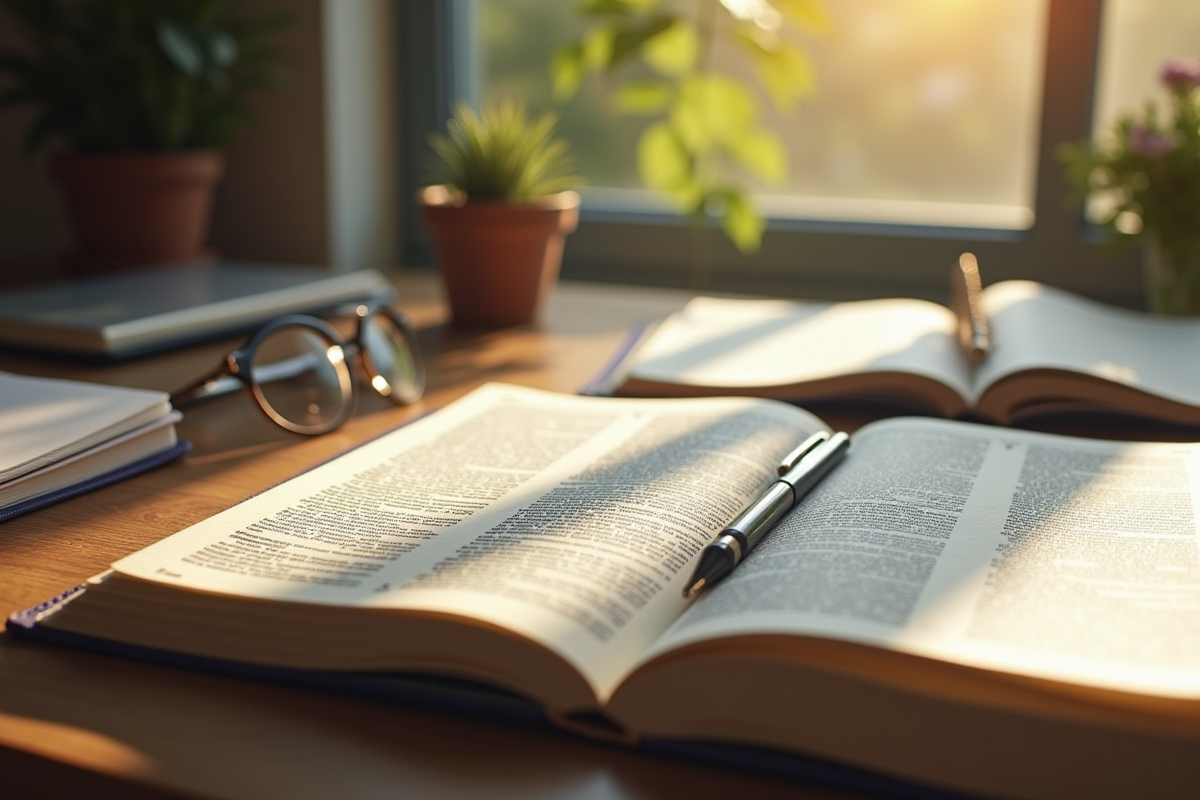Personne n’a jamais été condamné pour avoir écrit « cette après-midi » au lieu de « cet après-midi », et pourtant, la crainte de commettre une erreur grammaticale persiste, implacable, dans l’esprit de bien des francophones.
L’Académie française s’est penchée sur la question : le terme « après-midi » accepte à la fois le masculin et le féminin, une flexibilité qui n’efface pas les hésitations. D’un dictionnaire à l’autre, la préférence penche encore largement vers le masculin ; dans la vie réelle, les usages s’entremêlent, et les automatismes créent la confusion. À force de jongler avec les articles et les accords, même les locuteurs aguerris trébuchent, souvent par simple mimétisme ou sous l’influence de mots composés proches. Les accords de l’adjectif, les articles définis ou indéfinis, les ajustements dans la phrase : autant de pièges qui tendent la main à qui veut écrire sans faute.
Pourquoi tant d’hésitations autour de « cet après-midi » ?
L’expression « après-midi » concentre toutes les incertitudes. Officiellement, la langue tolère les deux genres. Mais l’Académie française, elle, affiche une nette préférence pour « cet après-midi », s’appuyant sur le voisinage du mot « midi », masculin par nature. Dans les textes administratifs, les courriels professionnels, la presse, cette forme s’impose. Mais la littérature, elle, s’affranchit volontiers de ces codes : chez Zola, Camus ou d’autres, le féminin s’invite pour souligner la douceur ou la longueur d’une après-midi particulière.
Ce flottement n’a rien d’anodin. Le genre du mot « après-midi » n’a jamais été verrouillé, ce qui laisse la porte ouverte aux influences. Certains francophones, portés par l’analogie avec « matinée » ou « soirée », choisissent le féminin. D’autres préfèrent la ligne académique, en misant sur le masculin. De là, les erreurs fleurissent : on lit parfois « cette après-midi ensoleillé », un mélange qui fait tiquer, ou des articles mal assortis.
Une règle simple peut pourtant éviter ces couacs : accorder l’adjectif et l’article selon le genre retenu, tout en conservant le trait d’union, jamais d’oubli à ce sujet.
| Genre | Exemple d’emploi | Source |
|---|---|---|
| masculin | cet après-midi pluvieux | Académie française |
| féminin | cette après-midi grise | Littérature (Zola) |
S’arrêter à une règle sèche serait réducteur. L’alternance entre « cet après-midi » et « cette après-midi » en dit long sur la vitalité de la langue, entre discordances, affirmations normatives et libertés créatives.
« Après-midi » : masculin, féminin ou les deux ?
Difficile de trouver plus ambivalent que « après-midi ». Les dictionnaires majeurs, Le Robert, Larousse, ainsi que l’Académie française, recommandent le masculin : « cet après-midi ». Ce choix s’explique facilement, puisqu’il s’appuie sur la parenté avec « midi », masculin lui aussi. L’administration, les médias, l’essentiel des textes officiels adhèrent à cette version.
Cependant, la langue française n’a jamais posé de ligne infranchissable. Le féminin, « cette après-midi », fait des incursions notables dans la littérature et les conversations du quotidien. Zola évoque « une après-midi grise et douce de novembre » ; Camus, lui aussi, penche parfois vers le féminin. Cette variante, même si elle reste minoritaire, s’appuie sur la logique qui rapproche « après-midi » de « matinée » ou « soirée », deux expressions féminines. Elle permet aussi de mettre l’accent sur la durée ou la tonalité particulière du moment vécu.
Voici les deux options principales et leurs usages :
- Masculin recommandé : « cet après-midi orageux »
- Féminin admis : « cette après-midi lumineuse »
Le choix du genre a des conséquences immédiates sur tous les accords. Cohérence et constance sont de mise : il ne s’agit pas de passer du masculin au féminin à l’intérieur d’un même texte. Le masculin domine, surtout à l’écrit, mais le féminin conserve une place singulière dans la tradition littéraire et dans certaines régions.
Les erreurs fréquentes à éviter pour ne plus se tromper
La formule « après-midi » traîne dans son sillage plusieurs erreurs récurrentes, aussi bien sur le papier qu’à l’oral. Premier point de vigilance : le trait d’union. Il s’impose partout, sauf lorsqu’il s’agit de désigner, littéralement, ce qui vient après midi (l’heure). Dans tous les autres cas, l’absence du trait d’union marque une faute remarquée. Les correcteurs automatiques, trop indulgents, la signalent rarement. Mais le respect de la norme passe par là.
Autre source de doute : le pluriel. Traditionnellement, « après-midi » ne se modifie pas (« des après-midi »). Depuis la réforme de 1990, on peut ajouter un « s » (« des après-midis »). Les deux formes passent, à condition de rester cohérent tout au long du texte, particulièrement dans un message professionnel ou une publication officielle.
Enfin, l’accord de l’adjectif démonstratif dépend du genre choisi. On écrit « cet après-midi » si l’on opte pour le masculin, « cette après-midi » si l’on préfère le féminin. Garder la même logique d’une phrase à l’autre évite toute ambiguïté, que ce soit dans un devoir d’école ou un rapport d’entreprise.
Voici trois pièges courants à repérer et contourner :
- Erreur fréquente : écrire « apres midi » sans trait d’union
- Hésitation sur le pluriel : invariable (« des après-midi ») ou accordé (« des après-midis ») selon la préférence
- Mauvais accord de l’adjectif démonstratif : respecter le genre adopté dès le départ
Maîtriser ces détails, c’est s’assurer une écriture nette et sans bavure. La langue française ne laisse que peu de place à l’approximation, surtout sur ces points qui trahissent la qualité d’un texte.
Des astuces simples pour progresser en orthographe au quotidien
La vigilance orthographique ne s’improvise pas : elle se construit, un mot après l’autre. Relire ses messages, même les plus courts, sur tous supports, reste un réflexe salutaire. Cette habitude affine peu à peu le regard, notamment sur des subtilités comme le genre de « après-midi ».
Pour ancrer la bonne forme, il existe des astuces qui fonctionnent : rattacher « après-midi » à « midi », mot masculin, facilite le choix du genre, surtout à l’écrit. Cette association visuelle, renforcée par la répétition dans la presse ou les romans, installe la structure correcte dans la mémoire. Accordez toujours l’adjectif démonstratif en conséquence : « cet » pour le masculin, « cette » pour le féminin, et tenez ce cap du début à la fin du texte.
Quelques réflexes à adopter pour éviter les fautes les plus courantes :
- Consulter un guide de grammaire ou le site de l’Académie française dès qu’un doute surgit, la réponse y est souvent limpide.
- Observer les usages dans les journaux ou les œuvres littéraires, où la diversité des formes aiguise l’intuition grammaticale.
- Utiliser le synonyme « aprem » dans les échanges familiers, ce qui évite de trancher sur le genre dans un cadre informel.
L’expression « après-midi » s’emploie dans toutes les positions dans la phrase : sujet, complément, circonstanciel de temps. Savoir reconnaître sa fonction aide à accorder correctement et à soigner l’écriture. L’exercice demande régularité et attention, mais il offre, à force de pratique, une satisfaction discrète : celle de manier la langue française avec justesse.
À force d’attention, les hésitations s’effacent et la maîtrise s’installe. Une simple décision sur le genre d’« après-midi » peut transformer le message, imposer une tonalité, révéler une culture. La langue, dans ses détails, ne pardonne rien, mais elle récompense ceux qui la respectent par la justesse du mot, et la clarté du sens.